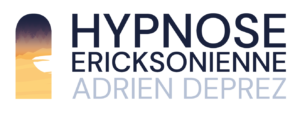Sur une aire d’autoroute, un homme fixe longuement un distributeur de boissons. Il ne choisit rien. Il regarde les canettes alignées comme s’il attendait qu’une réponse tombe du ciel. Un enfant tire sur la manche de sa veste, mais l’homme reste figé. Ce n’est pas la soif qui le retient, mais l’impossibilité de choisir. Toute boisson semble vide. Même les bulles sont muettes.
Ce malaise discret, presque imperceptible, dit pourtant quelque chose d’essentiel. Lorsque le langage se retire, que les mots ne tiennent plus le réel, il ne reste qu’un silence épais. Ce silence, c’est le vide qui dépasse, qui défait ce que chacun croyait être. L’angoisse ne naît pas du manque, mais de l’abondance sans contour, de l’espace sans nom, de l’absence de sens qui ne peut même pas être formulée.
Alors, des histoires s’inventent. Des récits sacrés ou intimes, des croyances bricolées, des concepts réconfortants. Tout pour ne pas tomber. Tout pour ne pas se dissoudre. Mais parfois, ce surgissement du vide résiste. Et dans cette faille, une possibilité apparaît. Peut-être que l’on ne guérit pas de l’angoisse. Peut-être qu’on apprend à l’habiter.

À l’abri du choix, le vide devient plus clair. (Image générée par DALLE d’OpenAI)
Quand le langage glisse, l’abîme murmure
Il suffit parfois d’un mot qui échappe, d’une phrase suspendue au bord d’un non-dit, pour que le sol se dérobe. Le langage, ce tissu fragile que nous tissons jour après jour pour contenir l’indicible, se déchire. Et à travers cette faille, c’est plus qu’un silence qui s’engouffre. C’est un vide. D’abord léger, presque poétique. Puis brutal, sans contour, sans nom. Ce vide, que nul discours ne parvient à border, révèle l’extrême précarité de nos fondations intérieures.
À l’instant précis où les mots vacillent, l’angoisse s’invite. Pas la peur rationnelle que l’on apprivoise par l’analyse, mais une angoisse brute, archaïque, silencieuse. Elle ne s’annonce pas. Elle surgit. Elle déborde les grilles du langage, et expose l’être à l’absence de sens comme on ouvre une plaie à l’air libre. L’expérience humaine contemporaine, saturée de récits formatés et d’images vides, peine à contenir cette fracture. Car ici, plus rien ne fait écran.
Le vide, cet insoutenable transparent
Le vide n’est pas simplement l’absence. Il est ce qui échappe à toute tentative de symbolisation. Il est ce que le langage ne peut fixer, ce que la pensée ne parvient pas à circonscrire. Et c’est précisément cette impossibilité qui rend le vide insoutenable. Car l’humain, de tout temps, a constamment œuvré à masquer ce rien par du récit. Des mythologies, des croyances, des moralités, des idéologies. Il s’est raconté des histoires pour ne pas sombrer dans ce qu’il sent, parfois confusément, au fond de lui : que rien n’a été promis.
Ce qu’on appelle souvent « perte de sens » n’est pas tant la disparition d’un contenu que la révélation d’un échec de la forme. Le langage, construit pour dire et pour relier, se heurte ici à un réel qui ne répond pas. Le vide devient alors visible, non pas comme une absence mais comme une présence muette, opaque, qui résiste à toute tentative d’élaboration.
Les récits comme pansements du néant
Pour ne pas dériver dans cette mer sans rivage, l’humain invente. Il produit des récits. Des codes. Des appartenances. Il s’attache à des promesses faites de mots, et ajuste son identité à ces formes langagières. Il devient sujet d’un discours qui le dépasse. Mais ces récits, parfois, se fissurent. Ils ne tiennent plus. Et lorsque le discours protecteur se délite, c’est le sujet lui-même qui vacille.
Ce n’est pas tant que nous manquons de sens, mais que les structures dans lesquelles nous croyons ce sens inscrit s’effondrent. De là, surgit l’angoisse. Une angoisse sans objet, sans cause, sans direction. Une angoisse qui n’est pas à comprendre, mais à traverser. Car vouloir lui donner un sens, c’est encore tenter de recouvrir le vide. Or ce vide, s’il est affronté, peut devenir source d’un autre rapport à soi.
Identité en ruine, sujet en devenir
L’identité, loin d’être une donnée fixe, est un montage fragile, constamment alimenté par le regard de l’autre, par les discours qui nous traversent, par les histoires que nous acceptons de raconter sur nous-mêmes. Elle est un point d’équilibre instable entre ce que nous croyons être et ce que nous pensons devoir être. Mais lorsque le sens s’efface, lorsque les coordonnées symboliques s’effondrent, ce montage se défait. Le sujet se retrouve face à une béance.
Cette confrontation n’est pas une fin. C’est un commencement. Dans cette brèche où tout vacille, une transformation devient possible. Il ne s’agit pas de réparer l’identité, mais d’en inventer une nouvelle forme. Ou plutôt, de permettre au sujet de s’inventer hors des récits contraints. L’angoisse, alors, devient passage. Elle cesse d’être une menace pour devenir appel. Non plus à fuir, mais à plonger.
La traversée de l’angoisse
Nul ne traverse le vide indemne. Il laisse des marques, silencieuses, souvent invisibles. Mais dans cette traversée, quelque chose se délie. À condition de ne pas refermer trop vite les plaies, de ne pas colmater l’insoutenable par des réponses toutes faites. Il faut du courage pour rester dans cette faille, du temps pour écouter ce qui y résonne. Car l’angoisse, si elle est vécue pleinement, peut ouvrir un espace de liberté radicale. Un espace où les anciens repères n’ont plus prise, et où peut émerger un autre rapport à soi, aux autres, au monde.
Les praticiens qui accompagnent ce processus le savent : il ne s’agit pas d’expliquer, mais de soutenir la chute. De créer un espace où la parole peut se risquer, même maladroite, même heurtée. Un lieu où le langage, dans son hésitation même, devient outil de transformation. L’écoute, ici, n’est pas un simple acte technique. Elle est une présence. Une manière de tendre la main dans le noir.
Vers une autre parole
Lorsque le langage reprend, après le vacillement, il n’est plus tout à fait le même. Il porte en lui la trace du silence traversé. Il devient plus dense. Moins bavard. Moins sûr. Il ne cherche plus à tout dire, mais accepte de laisser place à l’inconnu. Une parole née du vide ne cherche pas à le nier. Elle le borde. Elle en respecte la puissance. Et c’est peut-être là que réside la vraie transformation : non pas dans le retour à une normalité, mais dans l’invention d’un nouveau rapport au manque.
Ceux qui ont traversé l’angoisse ne regardent plus le monde de la même manière. Ils savent que derrière les mots se cache l’indicible. Que sous les certitudes palpite un abîme. Et pourtant, ils parlent. Mieux : ils laissent la parole advenir, dans son rythme propre, sans la forcer. C’est une parole qui ne comble pas, mais qui relie. Une parole qui ne décrit pas, mais qui touche.
L’hypnose : un pont entre les mondes
Il existe des pratiques qui ne cherchent pas à expliquer mais à accompagner. Des approches qui n’imposent pas de sens, mais qui soutiennent l’émergence d’un mouvement intérieur. L’hypnose, dans sa forme la plus subtile, peut être un de ces ponts. Elle ne vient pas remplir le vide. Elle aide à l’habiter. À le traverser. À en faire un lieu de création. Elle invite à écouter ce qui, en soi, résiste à la parole, à prêter attention aux mouvements souterrains du psychisme, à ces images qui parlent sans dire.
Le changement ne vient pas d’une injonction extérieure, mais d’un glissement interne. Parfois imperceptible. Comme un pli qui se défait. Une tension qui se relâche. Une voix intérieure qui s’apaise. L’hypnose ne cherche pas à imposer un discours. Elle crée les conditions pour qu’un nouveau récit puisse naître, plus fidèle à ce que l’on sent qu’à ce que l’on croit devoir être.
C’est là, dans les marges de la conscience, dans ce clair-obscur entre veille et sommeil, que s’esquisse la possibilité d’un autre rapport au vide. Non plus comme une menace, mais comme un espace à explorer. Un territoire intérieur où quelque chose peut enfin se dire autrement. Ou peut-être, pour la première fois, se taire autrement.
L’angoisse, alors, devient non plus une fin, mais une traversée. Un passage. Une épreuve d’où l’on revient changé. Et si le langage continue de vaciller parfois, il dessine aussi, dans sa faille, de nouvelles formes de présence.
Article créé avec la collaboration de ChatGPT d’OpenAI