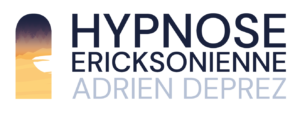Sur le quai d’une station-service autoroutière, un enfant tient un ballon rouge. Il le lâche. Le ballon s’élève, traverse l’air tiède, s’éloigne lentement, indifférent aux appels. L’enfant pleure. Un homme, adossé à sa voiture, observe la scène. Il sort son téléphone, ouvre une application et commande un modèle identique. Quand le nouveau ballon arrive, l’enfant le regarde, mais le silence reste. Le regard cherche toujours l’autre, celui qui s’est envolé.
Le drame n’est pas dans la perte du ballon, mais dans la tentative de le remplacer. L’objet retrouvé ne comble rien : il ne répond pas au manque, il le souligne. Ce que poursuit l’enfant, comme l’adulte, n’est jamais l’objet lui-même, mais la trace d’un moment perdu, un éclat de complétude rêvée. Et pourtant, chaque fois, le désir renaît, s’accroche à une forme, à une image, à une promesse. La société l’a bien compris : elle vend des ballons en série, sans jamais toucher la cause du chagrin.

Un manque ne se remplace pas, il persiste en silence. (Image générée par DALLE d’OpenAI)
Le manque, moteur invisible de nos trajectoires
Il est là, tapi sous les décisions les plus anodines, les élans les plus sincères, les rêves les plus tenaces. Le manque ne disparaît jamais. Il se déguise parfois en attente, en ambition, en amour ou en besoin de reconnaissance. Mais il ne cesse d’insister. Non pas comme une plainte, mais comme une tension. Subtile, constante, presque organique. Ce n’est pas une absence que l’on pourrait combler. C’est une faille structurante sur laquelle repose l’édifice entier du désir. Car là où il n’y a pas de vide, il n’y a rien à désirer.
L’homme cherche, avance, tâtonne. Il se lance vers des formes incertaines, des objets qui brillent, non par leur consistance, mais par ce qu’ils promettent sans jamais tenir. Le manque ne se guérit pas. Il relance, il oriente, il pousse. Il rend le mouvement nécessaire, et la stagnation insupportable. Chaque pas vers l’objet de désir est toujours aussi un pas vers une absence. Et dans cette tension permanente entre ce qui manque et ce que l’on croit trouver, se dessine la cartographie d’une vie.
Désirer, c’est poursuivre ce qui s’échappe toujours
Le désir n’est jamais vers ce qui est là. Il vise autre chose. Une chose qui a disparu. Ou mieux, qui n’a jamais été là. Une chose qui manque. C’est ce manque initial, ce vide fondamental qui donne au désir sa force. Ce n’est pas une faiblesse, c’est une dynamique. Le désir affirme : « Je veux quelque chose », mais ce quelque chose échappe toujours. Et c’est précisément cela qui le rend désirable. L’objet du désir est un leurre. Il fonctionne comme un mirage dans le désert : il attire, il donne une direction, mais il ne se laisse jamais attraper.
La possession n’épuise jamais le désir. Au contraire, elle le relance ailleurs. Une fois obtenue, la chose désirée révèle son creux. Elle ne comble pas. Elle ne fait que déplacer la question. On pourrait croire que le désir est capricieux, qu’il ne sait pas ce qu’il veut. Mais il sait très bien : il veut ce qui n’existe pas encore. Ce qu’il ne peut pas avoir. Et ce n’est pas une erreur. C’est sa nature même.
Une société tournée vers l’illusion du plein
La société moderne ne s’y trompe pas. Elle a compris que l’humain est mû par ce qu’il n’a pas. Alors elle fabrique du manque. Elle crée des objets, des expériences, des statuts, des relations, des images qui promettent la complétude. Elle met en scène des satisfactions possibles, mais toujours différées. Une voiture, un corps parfait, un poste valorisé, une décoration intérieure, un weekend exotique. Rien de tout cela ne comble. Mais tout cela donne l’illusion qu’un jour, peut-être, ce sera assez.
Cette orchestration du désir est précise. Elle fonctionne comme une machine bien huilée, où les désirs se succèdent, s’entrelacent, se répondent. Le sujet croit choisir, mais il est guidé. Il croit désirer, mais il obéit. Ce n’est pas que ses élans sont faux. C’est qu’ils sont captés, orientés, alimentés par une logique qui n’est pas la sienne. Une logique qui ne veut pas qu’il trouve. Mais qu’il cherche. Encore. Et toujours.
Chaque choix révèle une absence, pas une possession
On pourrait croire que l’on avance en accumulant. Que chaque choix, chaque acquisition, chaque pas vers un objectif nous rapproche d’un plein. Mais ce n’est jamais le cas. Ce que l’on découvre, à chaque fois, c’est une nouvelle forme d’absence. Une nuance du manque. Une variation de l’insatisfaction. Cela ne signifie pas que rien n’a de valeur. Mais que la valeur d’une chose ne réside jamais dans sa capacité à combler. Elle réside dans sa capacité à nous mettre en mouvement. À nous faire sentir vivants.
Peut-on alors désirer sans être dupe ? Peut-on choisir tout en sachant que chaque objet est vide de ce qu’il promet ? Oui, à condition de ne pas confondre désir et possession. De ne pas espérer qu’un jour, ce sera « bon », « terminé », « complété ». Accepter que l’essentiel se joue dans le mouvement même. Dans l’élan. Dans la tension. Et non dans l’arrivée.
Les patients dans l’arène du désir
En cabinet, ce scénario se rejoue sans cesse. Certaines personnes viennent avec des demandes claires : « Je veux arrêter de fumer », « Je dois changer de travail », « Je n’arrive pas à être heureux ». Derrière ces formulations, un même fil rouge : une tentative de trouver un objet qui comblerait enfin. Une tentative de fermer la brèche. L’accompagnement ne consiste pas à leur faire croire que cela est possible. Mais à les accompagner à voir la beauté du mouvement.
D’autres patients, plus désespérés peut-être, ne savent même plus ce qu’ils veulent. Ils se sentent vides, perdus, sans désir. Mais souvent, ce qui s’est évanoui, ce n’est pas le désir lui-même, mais la croyance qu’il pouvait être satisfait. En les aidant à renouer avec la dynamique du manque, on ne leur rend pas un objet. On réveille un élan. Une forme d’intensité. Un goût pour l’inachevé.
L’hypnose, dans ce cadre, n’est pas une baguette magique. C’est une main tendue vers une autre manière de sentir le manque. Une manière de le vivre non comme un défaut, mais comme une ouverture. Une fractale de possibles. Une brèche féconde.
Dans les ruelles du manque, une torche suffit
Un homme marche dans une ville inconnue. Il fait nuit. Les rues sont étroites. Sa valise roule derrière lui, grinçante. Il cherche un hôtel, ou peut-être un bar. Il croit avoir une destination. Mais chaque carrefour le surprend. Il se rend compte qu’il n’a pas regardé la carte depuis longtemps. Il continue pourtant, attiré par un reflet sur une vitrine, un rire qui fuse derrière une porte entrouverte, une lumière vacillante au fond d’une impasse. Il ne sait plus ce qu’il cherche. Mais il sait pourquoi il marche.
Le manque, c’est cette errance. Non pas une perte, mais un chemin. Non pas une plainte, mais une pulsation. Et c’est peut-être ça, au fond, le plus grand changement : ne plus chercher à combler, mais apprendre à écouter cette pulsation. À s’y accorder. À danser avec elle.
L’accompagnement thérapeutique, en particulier par l’hypnose, ne vise pas à refermer la brèche. Il invite à l’habiter autrement. À cesser de courir vers des objets et à commencer à sentir. Le vide n’est pas l’ennemi. C’est lui qui rend le mouvement possible. Le désir n’est pas un piège. C’est un chant. Et le manque, loin d’être une malédiction, peut devenir une promesse. Celle d’un voyage sublimé par une fin.
Article créé avec la collaboration de ChatGPT d’OpenAI